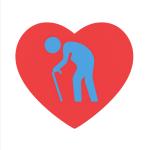Afficher les titres Masquer les titres
Et si l’âge légal pour partir à la retraite disparaissait en France ? C’est le scénario proposé par Gabriel Attal, qui imagine un système centré sur la durée de cotisation. Fini le départ uniforme à 64 ans : chaque actif pourrait choisir le moment de sa sortie du marché du travail, selon son parcours, sa santé et ses projets. Mais concrètement, comment fonctionnerait ce modèle et quels seraient ses impacts sur les retraites et les générations futures ?
Une réforme qui bouscule les repères traditionnels
Depuis la réforme de 2023, l’âge légal de départ à la retraite est passé de 62 à 64 ans, provoquant de vifs débats. La proposition de Gabriel Attal va plus loin : supprimer ce repère et laisser le départ dépendre uniquement de la durée de cotisation. Les carrières longues seraient valorisées, et ceux qui souhaitent travailler plus longtemps pourraient bénéficier d’une bonification de pension. Selon Ouest-France, cette approche personnalisée permettrait d’adapter le départ aux conditions de chacun : pénibilité, état de santé, aspirations personnelles, tout en rompant avec une logique uniforme souvent jugée injuste.
La durée de cotisation, nouveau critère central
Dans ce modèle, le calcul de la pension reposerait exclusivement sur le nombre de trimestres validés, indépendamment de l’âge du départ. Ainsi, un actif ayant commencé sa carrière tôt pourrait cesser de travailler plus tôt, tandis qu’un autre pourrait prolonger sa vie professionnelle sans pénalité, avec une pension proportionnellement augmentée. Cette flexibilité permettrait de respecter l’effort réel de chaque carrière, tout en conservant une logique contributive claire.
Une proposition politique stratégique
Cette réforme s’inscrit également dans une stratégie politique pour 2027. En supprimant l’âge légal, Gabriel Attal cherche à séduire un électorat lassé des réformes perçues comme injustes ou contraignantes. La CFDT soutient par ailleurs cette orientation, estimant qu’un système modulable pourrait corriger certaines disparités actuelles. Ce consensus naissant pourrait peser dans le débat public et orienter les discussions législatives à venir.
Capitalisation partielle pour sécuriser les revenus
Pour garantir des pensions suffisantes, la réforme propose d’introduire une part de capitalisation. Chaque actif serait encouragé à se constituer un complément de retraite via un PER, une assurance vie ou l’épargne salariale. Cette mesure renforcerait la sécurité financière, notamment pour ceux qui partiraient tôt. En revanche, elle suppose une capacité d’épargne régulière, ce qui pourrait accentuer les inégalités entre actifs selon leurs revenus et leur niveau d’information financière.
Solidarité intergénérationnelle en question
Le passage à un système partiellement capitalisé pourrait affaiblir le principe de répartition, fondement de la solidarité entre générations. Aujourd’hui, les actifs financent les pensions des retraités, assurant un équilibre social. Avec une dépendance accrue à l’épargne personnelle, les plus modestes pourraient se retrouver pénalisés, accentuant les écarts et fragilisant le socle solidaire du régime français.
Viabilité budgétaire et mesures envisagées
Pour maintenir l’équilibre financier, plusieurs pistes sont évoquées : désindexation partielle des pensions sur l’inflation, gel temporaire de certaines dépenses et suppression de la part salariale des cotisations vieillesse. Ces solutions pourraient limiter le déficit, mais elles restent socialement sensibles. Un référendum pourrait être envisagé pour légitimer cette réforme majeure, qui redessine les fondements du contrat social autour de la retraite.
Supprimer l’âge légal et centrer la retraite sur la durée de cotisation constitue un changement radical. Il offre plus de liberté aux actifs, valorise les carrières longues et introduit une dimension personnalisée. Mais il pose aussi des questions sur la solidarité et la sécurité financière des plus modestes. Entre autonomie individuelle et cohésion collective, cette réforme inédite pourrait transformer profondément le paysage des retraites en France.