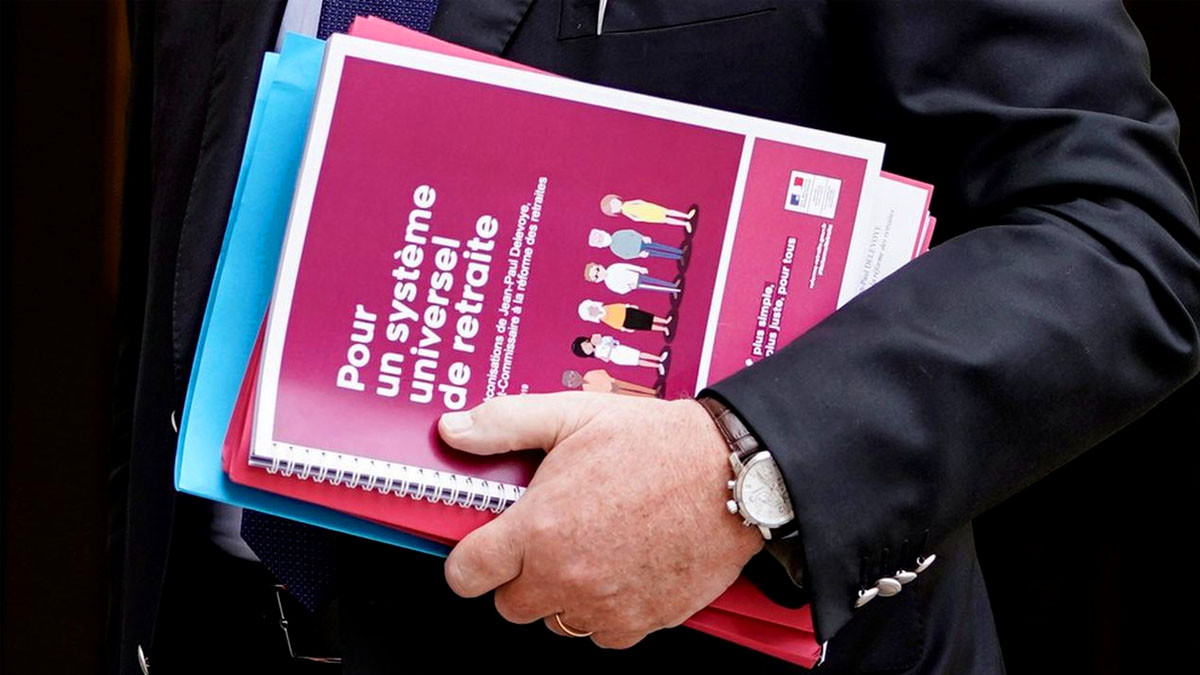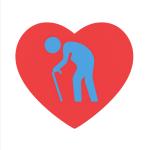Afficher les titres Masquer les titres
La nouvelle risque de faire grincer bien des dents. Alors que la dernière réforme des retraites est encore fraîche dans les mémoires, une nouvelle piste vient de refaire surface : repousser l’âge légal de départ à la retraite à 66 ans et demi d’ici 2070. C’est ce que propose le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans un rapport qui relance le débat sur l’avenir du système. Une mesure qui divise, entre logique économique et fatigue sociale.
Pourquoi parle-t-on d’un départ à 66 ans et demi ?
Le COR tire la sonnette d’alarme : si rien ne change, le système de retraite pourrait s’enfoncer dans le rouge. D’après ses prévisions, le déficit passerait de 0,1 % à 1,4 % du PIB entre 2024 et 2070. La principale cause ? Des recettes qui diminuent, alors que les dépenses restent stables.
Pour redresser la barre, plusieurs solutions ont été envisagées. Mais plutôt que de toucher aux pensions ou d’augmenter les cotisations, c’est le report de l’âge légal de départ qui semble tenir la corde. L’idée est de préserver l’économie tout en évitant de trop charger les générations actuelles.
Un calendrier de recul progressif
Pas question de tout bouleverser d’un coup. Le COR propose un calendrier étalé sur plusieurs décennies. Voici les étapes prévues :
- 64,3 ans dès 2030 ;
- 65,9 ans autour de 2045 ;
- 66,5 ans à l’horizon 2070.
L’objectif ? Garantir un équilibre budgétaire sans pénaliser trop durement ceux qui sont proches du départ. Cette montée en douceur permettrait aussi d’éviter un choc brutal pour les carrières longues.
Mais dans les faits, l’idée de devoir travailler jusqu’à presque 67 ans inquiète. La question de la pénibilité, du taux plein ou encore de la capacité à rester employable à cet âge-là revient souvent dans les discussions.
Pourquoi les autres pistes ont été écartées
Avant de choisir le report de l’âge légal, le COR a passé en revue d’autres options. Réduire les pensions ? Trop impopulaire et risqué pour le pouvoir d’achat. Augmenter les cotisations ? Cela aurait pesé lourdement sur les actifs et les entreprises.
Quant à l’idée de taxer davantage les retraités aisés, elle a été jugée difficile à appliquer et peu efficace pour combler le trou. Les résistances sociales sont vives dès qu’il s’agit de toucher aux acquis des retraités, ce qui rend cette piste politiquement délicate.
En fin de compte, le relèvement de l’âge est vu comme la solution la moins conflictuelle… même si elle reste très contestée.
Des répercussions sociales à anticiper
Travailler plus longtemps n’est pas une option neutre. Pour beaucoup, c’est une charge supplémentaire. Ceux qui occupent des métiers physiques ou usants sont particulièrement exposés. Et même si certains aménagements permettent un départ anticipé, le taux plein pourrait devenir un mirage pour beaucoup.
Autre impact direct : l’arrêt progressif des allocations chômage à l’âge de la retraite. Si l’âge de départ recule, certains seniors risquent de rester plus longtemps sans emploi, sans pour autant pouvoir partir à la retraite.
- Risque accru de précarité pour les seniors ;
- Plus de retraites à taux minoré via la décote ;
- Des tensions intergénérationnelles sur fond de solidarité.
Une réforme qui divise syndicats et politiques
La proposition du COR intervient alors que se déroulent les derniers débats sur l’avenir du système. Et du côté des syndicats, le ton monte. La CGT parle d’une réforme « imposée par le gouvernement, sans vraie concertation ».
Pour beaucoup de représentants des salariés, c’est un passage en force. Après avoir déjà reculé l’âge de 62 à 64 ans, repousser encore le curseur vers 67 ans est vécu comme une forme de mépris social. Certains redoutent que l’accès au taux plein devienne un luxe réservé aux cadres.
Et ailleurs en Europe ?
La France n’est pas seule dans cette course à l’allongement de la vie active. Le Danemark, par exemple, prévoit une retraite à 70 ans dès 2040. L’Allemagne et l’Italie suivent la même logique, en adaptant l’âge de départ à l’espérance de vie.
Ces comparaisons nourrissent le débat en France : faut-il suivre la tendance ou préserver un modèle plus protecteur ? En tout cas, le recul de l’âge apparaît comme une orientation quasi inévitable à l’échelle européenne.
Mais derrière les chiffres, le choix politique reste délicat. Demander aux jeunes générations de travailler plus longtemps, sans leur garantir une retraite digne, c’est prendre le risque de fractures sociales profondes. Chaque réforme semble accentuer les inégalités, entre ceux qui peuvent prolonger leur carrière et ceux que l’usure professionnelle rattrape trop tôt.
Et maintenant ?
Ce projet de retraite à 66 ans et demi n’est encore qu’une proposition. Mais il donne le ton. Le débat est loin d’être clos, et les prochains mois s’annoncent agités entre syndicats, gouvernement et citoyens.
Ce qui est sûr, c’est que la question du vieillissement au travail est devenue centrale. Travailler plus longtemps, oui… mais à quel prix ? Et pour quelle qualité de vie après ?