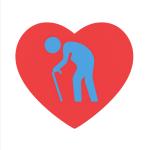Afficher les titres Masquer les titres
Beaucoup de Français attendent la retraite comme une libération : plus de réveil matinal, moins de stress professionnel, davantage de temps pour soi, la famille, les loisirs. Mais derrière cette image idéale se cache une réalité moins rassurante : la fin de la vie active s’accompagne presque toujours d’une baisse de revenus. Pour certains profils, cet écart entre le dernier salaire et la pension peut être très important. D’où une question simple mais cruciale : quelle somme faut-il vraiment épargner pour ne pas se serrer la ceinture une fois à la retraite ?
Préparer cette étape ne consiste pas seulement à remplir des formulaires ou à vérifier ses trimestres. Il s’agit aussi d’anticiper son niveau de vie, ses projets, et les dépenses qui continueront de tomber chaque mois. Plus tôt on se pose ces questions, plus on a de chances d’y répondre sereinement.
La retraite : un moment de vie, mais aussi un choc de revenus
La retraite marque un tournant sur le plan personnel, mais aussi une vraie rupture financière. En quittant la vie active, on ne perçoit plus de salaire, mais des pensions, souvent moins élevées. Ce décalage peut surprendre, surtout lorsque l’on n’a pas pris la mesure de la baisse à venir.
Certains profils sont particulièrement exposés à cette chute de revenus. C’est le cas des cadres du secteur privé, dont les rémunérations confortables en fin de carrière contrastent fortement avec le montant de leur pension. Plus le salaire est élevé, plus la différence entre la dernière fiche de paie et le premier versement de retraite peut être marquée.
Les fonctionnaires ne sont pas épargnés, en particulier ceux dont une grande part de la rémunération repose sur des primes. Ces primes, qui pèsent lourd dans le budget mensuel, ne sont pas prises en compte de la même manière dans le calcul de la retraite. Résultat : un écart significatif entre revenus d’activité et pension finale.
Un taux de remplacement très variable selon les profils
Pour mesurer cette baisse, les spécialistes utilisent une notion clé : le taux de remplacement. Il s’agit du rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net. Ce pourcentage permet de voir, concrètement, quelle part de son niveau de vie on conserve une fois à la retraite.
Les chiffres montrent de grands écarts selon les situations. Pour la génération née en 1963, qui arrive justement à l’âge de la retraite, le taux de remplacement peut être relativement élevé pour certains. Une salariée non-cadre du privé avec deux enfants voit, par exemple, son taux de remplacement estimé à près de 80 %. Elle conserve donc une grande partie de ses anciens revenus.
Mais pour un salarié cadre du privé, ce taux chute autour de 51,5 %. Il ne retrouve qu’un peu plus de la moitié de son dernier salaire. Pour un fonctionnaire avec un niveau de primes élevé, le taux tombe même sous les 50 %, à environ 45,6 %. Avec de telles différences, deux personnes ayant gagné correctement leur vie peuvent connaître des situations très contrastées une fois à la retraite.
Combien faut-il épargner pour compléter sa pension ?
Face à ces écarts, une idée s’impose : il est essentiel d’anticiper et de se constituer une épargne pour compléter la pension de retraite. Mais quel montant viser ? Là encore, tout dépend du niveau de vie souhaité et du rendement de l’épargne mise de côté.
Les spécialistes donnent un exemple concret : pour obtenir un complément de retraite de 1 000 euros par mois pendant 20 ans, il faudrait disposer d’un capital d’environ 196 217 euros si l’épargne est rémunérée à 2 % par an. Autrement dit, ce capital permettrait de piocher chaque mois sans épuiser trop vite l’enveloppe, grâce aux intérêts générés.
Si le rendement grimpe à 5 % par an, le capital nécessaire baisse nettement. Dans ce scénario, 149 547 euros suffiraient pour toucher ce même complément de 1 000 euros sur 20 ans. Cette différence montre à quel point le choix des supports d’investissement, et donc le rendement, peut influencer l’effort d’épargne à fournir.
Commencer tôt : un atout décisif pour bâtir son capital
Une chose est sûre : plus on commence à épargner tôt, plus l’objectif devient atteignable. Étaler l’effort sur de nombreuses années permet de mettre de côté des sommes plus modestes chaque mois, tout en profitant des intérêts composés au fil du temps.
Les experts recommandent souvent de vraiment se pencher sur sa stratégie d’épargne une fois la résidence principale acquise. Être propriétaire de son logement est un élément important de sécurité financière à la retraite. Certes, l’achat et les travaux représentent des frais importants, mais à long terme, cela évite les hausses de loyer et les incertitudes liées au marché locatif.
Ne plus avoir de loyer à payer, ou au moins disposer d’un bien immobilier, allège fortement les charges fixes au moment de la retraite. Cela laisse davantage de marge pour consacrer son budget aux dépenses de santé, aux loisirs, aux voyages, ou simplement au quotidien.