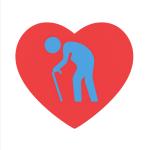Afficher les titres Masquer les titres
En théorie, occuper illégalement le logement d’autrui est un délit lourdement sanctionné. En pratique, les propriétaires se heurtent souvent à un mur juridique et administratif lorsqu’ils tentent de récupérer leur bien. Malgré la loi du 27 juillet 2023, censée renforcer la protection des victimes, expulser un squatteur demeure un chemin long et semé d’embûches. Mais pourquoi est-ce encore si difficile de mettre fin à une telle occupation ?
Le squat, une notion plus étroite qu’on ne l’imagine
Selon la loi, un squat correspond à l’occupation d’une résidence principale ou secondaire sans l’accord du propriétaire. L’intrusion doit résulter de menaces, d’effraction ou de manœuvres frauduleuses. La sanction est sévère : jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.
Mais cette définition ne couvre pas toutes les situations. Si un locataire reste après la fin de son bail sans payer, il n’est pas considéré comme squatteur. De même, une personne hébergée qui refuse de partir, un sous-locataire installé sans autorisation ou un voyageur Airbnb qui change les serrures après son séjour ne relèvent pas du cadre légal anti-squat. Résultat : beaucoup de cas échappent aux mesures de protection renforcées prévues par la loi de 2023.
À noter que la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars), qui interdit d’expulser un locataire, ne s’applique pas aux squatteurs. En théorie, leur expulsion reste possible même en hiver.
Un propriétaire sans pouvoir direct
Face à des intrus installés dans sa maison, l’instinct premier du propriétaire est souvent d’intervenir lui-même. Pourtant, la loi l’interdit strictement. Forcer la porte, couper l’électricité ou menacer les occupants expose le propriétaire à des poursuites. Le Code pénal protège le domicile, même occupé illégalement, et impose de passer par une procédure encadrée.
Cette contrainte, bien que frustrante, vise à éviter des dérives. Mais elle laisse souvent les propriétaires désemparés, coincés entre la colère, la perte financière et le respect d’une procédure qui peut s’étirer sur plusieurs mois.
Une procédure d’expulsion qui prend du temps
La loi anti-squat de 2023 a instauré une procédure dite simplifiée. Désormais, un propriétaire peut solliciter directement le préfet pour obtenir l’évacuation. Mais même cette voie accélérée reste lourde et demande plusieurs étapes obligatoires.
Le chemin commence par un dépôt de plainte pour violation de domicile. Ensuite, le propriétaire doit prouver qu’il est bien l’occupant légitime du logement. Cela peut passer par un titre de propriété, des factures ou une attestation de tiers. Si les justificatifs sont inaccessibles à cause des squatteurs, le préfet doit se tourner vers l’administration fiscale pour confirmer la propriété dans un délai de 72 heures.
Enfin, un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice doit constater officiellement la présence des squatteurs. Ce constat est indispensable pour enclencher la procédure.
Quand le préfet entre en jeu
Une fois le dossier constitué, le préfet dispose de 48 heures pour prendre une décision. Avant d’ordonner l’expulsion, il doit étudier la situation personnelle des occupants : enfants mineurs, grossesse, handicap, précarité… Ces éléments peuvent ralentir, voire bloquer la procédure.
Si le préfet valide la demande, un arrêté est notifié aux squatteurs et affiché sur la mairie ainsi que sur le logement. Les occupants ont alors 24 heures pour quitter les lieux. En cas de refus, les forces de l’ordre interviennent. Parallèlement, le procureur peut engager des poursuites pénales. Mais dans la pratique, cette chronologie est rarement aussi rapide et linéaire.
L’option du juge : une autre bataille
Quand la voie préfectorale échoue ou s’avère trop complexe, le propriétaire peut saisir le juge. Cette procédure passe par un avocat et vise à obtenir une décision d’expulsion ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle s’adresse notamment aux situations non couvertes par la loi anti-squat.
Une fois les squatteurs condamnés, ils disposent d’un mois pour partir. S’ils refusent, un huissier délivre un commandement de quitter les lieux. Sans départ volontaire, l’huissier sollicite alors le concours de la force publique auprès du préfet. Là encore, les délais s’allongent, et l’attente devient insupportable pour les propriétaires concernés.
Un système protecteur, mais souvent incompris
En somme, le dispositif juridique vise à trouver un équilibre entre la protection du droit de propriété et le respect de la dignité des personnes en difficulté. Mais dans la réalité, ce cadre se traduit par des procédures longues et lourdes qui laissent un goût amer aux victimes. Beaucoup ont l’impression que la loi protège davantage les intrus que les légitimes propriétaires.
Cette situation explique la colère récurrente qui s’exprime chaque fois qu’un cas de squat fait la une. Car derrière les chiffres et les articles de loi, il y a toujours des familles qui voient leur maison, parfois leur résidence principale, occupée contre leur gré. Et leur quotidien se transforme alors en véritable parcours du combattant.