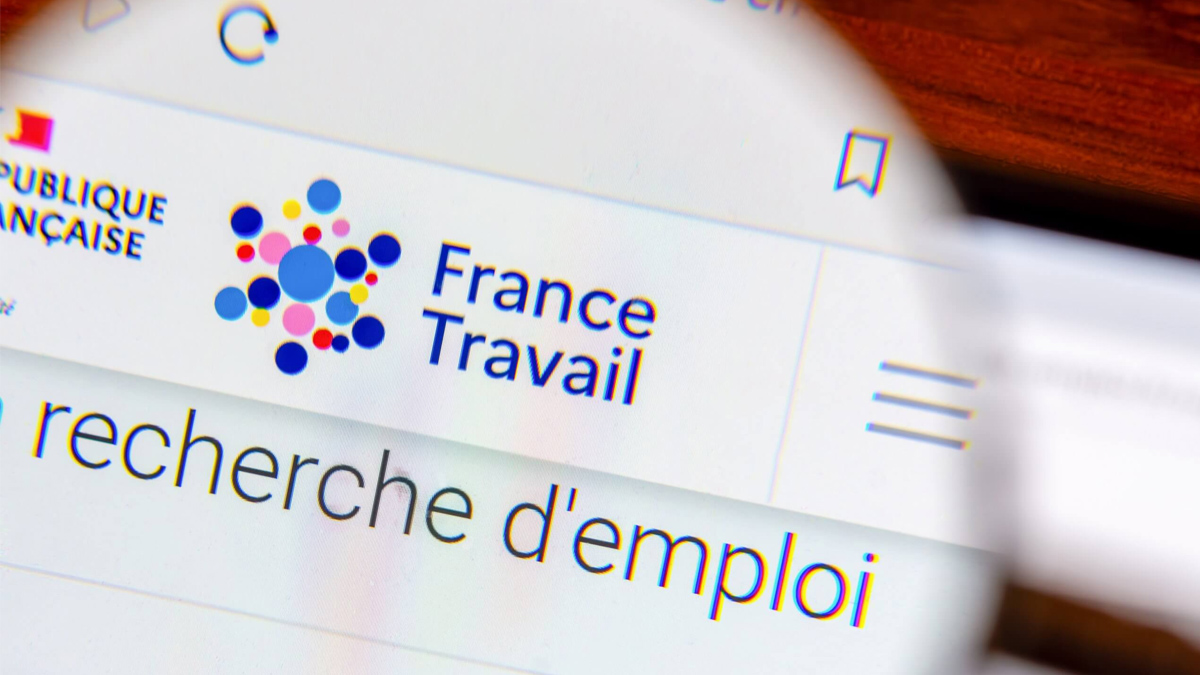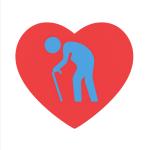Afficher les titres Masquer les titres
Depuis le 1er janvier 2024, une règle importante est entrée en vigueur pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) et ceux en mission d’intérim. Refuser une offre en CDI peut désormais entraîner la suppression des allocations chômage. Cette nouvelle mesure, confirmée récemment par le Conseil d’État, modifie profondément la donne pour les demandeurs d’emploi et impose de réfléchir à deux fois avant de dire non à un poste stable.
Une décision du Conseil d’État qui fait trembler
Le 18 juillet 2025, le Conseil d’État a rejeté les demandes de plusieurs syndicats qui souhaitaient bloquer cette nouvelle règle. Depuis le début de l’année 2024, si un salarié en CDD ou intérim refuse deux offres raisonnables d’emploi (ORE) en CDI dans les 12 mois qui suivent la fin de son contrat, il peut se voir privé de son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Cette sanction marque un tournant dans la manière dont l’assurance chômage gère les refus d’emploi.
Le but affiché est clair : encourager la reprise rapide d’un travail durable et lutter contre le chômage de longue durée. Mais la mise en œuvre suscite aussi des inquiétudes, notamment chez ceux qui craignent une pression trop forte sur les salariés en situation précaire.
Qu’est-ce qu’une offre raisonnable d’emploi ?
La notion d’« offre raisonnable » est au cœur du dispositif. Pour être considérée comme telle, une proposition doit répondre à plusieurs critères précis. Capital détaille ces conditions :
- L’emploi proposé doit correspondre au métier exercé ou à un poste similaire ;
- La rémunération doit être au moins équivalente à celle du précédent contrat ;
- La durée de travail doit être identique ou très proche.
Ces critères visent à éviter que les offres soient trop éloignées des compétences ou des attentes du salarié. Par ailleurs, le Conseil d’État insiste sur le fait que le salarié doit bénéficier d’un délai raisonnable pour étudier l’offre et y répondre. Ce temps de réflexion est essentiel pour que la décision soit prise en connaissance de cause.
Une procédure stricte pour l’employeur et le salarié
L’employeur doit formuler son offre de CDI de manière officielle et traçable. Cela signifie que la proposition doit être envoyée par un moyen qui atteste la date d’envoi et la réception par le salarié (courrier recommandé, mail avec accusé de réception, etc.).
De plus, l’entreprise est tenue d’indiquer clairement au salarié le délai qu’il a pour répondre. Ce cadre formalise la relation et évite les malentendus. En cas de refus, l’employeur dispose ensuite d’un mois pour signaler ce refus à France Travail, l’organisme en charge du chômage.
France Travail a alors la responsabilité d’informer le demandeur d’emploi des conséquences, notamment la possible suppression de son allocation chômage. Ce suivi est un volet important pour garantir la transparence et le respect des droits du salarié.
Quels impacts pour les salariés en fin de contrat ?
Cette nouvelle règle change la donne pour les milliers de salariés en CDD ou intérim chaque année. Ceux qui refusent une offre de CDI conforme aux critères prennent le risque de perdre une aide financière souvent indispensable. La menace pèse particulièrement sur les profils précaires ou ceux qui peinent à retrouver un emploi stable.
Par conséquent, ces salariés doivent désormais peser avec soin les avantages et les inconvénients d’un refus. Accepter un CDI peut assurer un revenu plus sûr, mais certains peuvent hésiter si le poste proposé ne correspond pas parfaitement à leurs aspirations ou contraintes personnelles.
De plus, cette règle pose un véritable dilemme entre liberté individuelle et impératif économique. Pour beaucoup, dire non à une offre est un droit fondamental. Désormais, ce choix pourrait entraîner des conséquences lourdes, ce qui alimente un débat sur l’équilibre entre protection sociale et exigence d’employabilité.
Ce que vous devez retenir
Si vous êtes salarié en CDD ou mission d’intérim, réfléchissez bien avant de refuser une offre en CDI. Cette décision pourrait affecter votre avenir financier et professionnel. Assurez-vous que l’offre soit conforme aux critères d’emploi similaire, salaire et durée de travail. Prenez le temps d’étudier les propositions et n’hésitez pas à demander conseil pour comprendre toutes les implications.
La loi est claire, mais son application peut sembler rigoureuse. Face à ce contexte, bien s’informer et anticiper ses choix devient une nécessité pour éviter les mauvaises surprises.
Et vous, comment vivez-vous cette nouvelle règle ? Pensez-vous qu’elle favorise la reprise d’emploi ou qu’elle pénalise injustement les demandeurs d’emploi ? Partagez votre point de vue, votre expérience compte dans ce débat qui touche de près la vie professionnelle de nombreux Français.