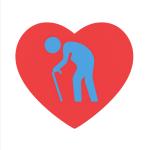Afficher les titres Masquer les titres
En 2025, la France se félicite de compter 400 000 passoires énergétiques de moins sur le territoire. Sur le papier, le chiffre impressionne et semble marquer une étape décisive dans la lutte contre les logements mal isolés. Mais derrière cette bonne nouvelle apparente, la réforme du DPE (diagnostic de performance énergétique) vient brouiller les cartes. Entre changement de méthode de calcul, nouveaux seuils et effets de seuil pour les petites surfaces, il devient difficile de démêler ce qui relève d’un véritable progrès thermique et ce qui tient surtout du tour de passe-passe statistique.
Réforme du DPE : une baisse des passoires surtout comptable
Depuis le 1er janvier 2025, la France ne recense plus 5,8 millions, mais environ 5,4 millions de logements classés F ou G. Autrement dit, 400 000 logements ont quitté la catégorie des passoires énergétiques en un an. Pourtant, cette amélioration spectaculaire n’est pas principalement liée à une vague de rénovations massives. Elle découle surtout de la nouvelle manière de calculer le DPE, notamment pour les petites surfaces.
Le diagnostic de performance énergétique attribue à chaque logement une étiquette allant de A à G, en fonction de sa consommation d’énergie et de ses émissions de CO₂. Jusqu’ici, les petites surfaces, en particulier les studios de moins de 40 m² chauffés à l’électricité, étaient souvent pénalisées par le mode de calcul. La réforme a corrigé ce biais en ajustant les seuils. Résultat : sans poser la moindre laine de verre ni changer un radiateur, des milliers de petits logements ont gagné une ou deux classes sur leur étiquette.
Selon le SDES (Service des données et études statistiques), près de 38 % de la baisse des passoires énergétiques est liée à cette seule modification méthodologique. Dit autrement, la France ne chauffe pas forcément mieux, elle compte surtout différemment. Une nuance de taille quand il s’agit d’évaluer l’efficacité de la transition énergétique.
2026 : une nouvelle étape qui dopera encore les “bonnes” notes
La réforme du DPE ne s’arrête pas là. En 2026, un nouveau changement viendra encore modifier le paysage énergétique : la révision du coefficient de conversion de l’électricité, abaissé de 2,3 à 1,9. Ce chiffre sert à traduire la consommation électrique en énergie primaire et tient davantage compte du poids du nucléaire et des énergies renouvelables dans le mix français.
Concrètement, cette nouvelle règle pourrait faire sortir jusqu’à 700 000 logements du statut de passoire énergétique, là encore sans le moindre travaux. Les logements chauffés à l’électricité, déjà avantagés par la première vague de réforme, seront une nouvelle fois gagnants. À l’inverse, les logements au fioul ou au gaz, eux, ne verront pas leurs notes s’améliorer mécaniquement.
Ce décalage alimente un sentiment d’injustice chez certains propriétaires de maisons anciennes chauffées au gaz ou au fioul, qui doivent financer des rénovations lourdes pour espérer remonter de classe. La Cour des comptes elle-même rappelle que « la fiabilité du DPE demeure fragile et doit être renforcée par une meilleure formation des diagnostiqueurs ». Un avertissement qui montre que la confiance dans cet outil clé de la rénovation énergétique n’est pas encore acquise.
Un marché immobilier coupé en deux par la nouvelle grille énergétique
La réforme du DPE ne se contente pas de changer des chiffres dans des rapports : elle rebat aussi les cartes du marché immobilier. Les logements classés F ou G sont devenus les mauvais élèves du parc : fortement décotés à la revente et, à terme, interdits à la location. Depuis le 1er janvier 2025, les biens classés G ne peuvent déjà plus être loués ; les F suivront en 2028, puis les E en 2034. Un calendrier qui pèse sur les stratégies des propriétaires.
Dans ce contexte, le marché se fracture. D’un côté, les logements reclassés de G à E retrouvent de l’attrait, voire une seconde vie. Ils échappent à la catégorie “passoire” et deviennent de nouveau finançables et louables. De l’autre, les biens restés dans le bas du classement subissent une véritable peine de marché, avec une décote estimée entre 15 et 25 %. Pour certains investisseurs, c’est une aubaine tombée du ciel ; pour d’autres, un mirage réglementaire qui masque la réalité des travaux à venir.
Les professionnels du bâtiment, eux, gardent la tête froide. Malgré la baisse officielle du nombre de passoires, leurs carnets de commandes ne reflètent pas encore une explosion de la demande. Près de cinq millions de logements F ou G restent à rénover, ce qui représente un chantier gigantesque pour les années à venir. Les artisans savent que la vraie bataille se jouera sur la capacité des ménages à financer les travaux et sur la stabilité des règles dans le temps.
La question de l’âge et du profil des propriétaires ajoute une dimension sociale au dossier. Selon le SDES, près d’un cinquième des bailleurs de plus de 80 ans détiennent encore un logement classé F ou G. Souvent modestes et peu enclins à engager des travaux lourds, ces propriétaires risquent d’être poussés hors du marché locatif si les aides publiques ne sont pas renforcées et simplifiées.
Une réforme qui change aussi les réflexes des acheteurs et des locataires
Au-delà des chiffres, la réforme du DPE modifie déjà le comportement des ménages. Pour de nombreux acheteurs, l’étiquette énergétique est devenue un critère déterminant, au même titre que l’emplacement ou la surface. Un logement récemment reclassé peut désormais peser lourd dans une décision d’achat, surtout pour un projet d’investissement locatif.
À l’inverse, les biens restés classés F ou G sont de plus en plus écartés des recherches, souvent dès le premier filtre sur les sites d’annonces. La perspective d’une interdiction de location, ou d’un chantier à plusieurs dizaines de milliers d’euros, refroidit acheteurs comme locataires. Pour les propriétaires concernés, le message est clair : soit ils rénovent, soit ils vendent rapidement, soit ils acceptent une forte baisse de valeur de leur patrimoine.
Les spécialistes de l’énergie le répètent : l’efficacité de cette réforme dépendra beaucoup de la fiabilité du diagnostic et de la stabilité des règles. Si l’échelle change trop souvent, difficile pour les ménages d’y voir clair et pour les artisans de planifier leurs capacités. Entre véritables progrès thermiques et simples ajustements de calcul, l’enjeu des prochaines années sera donc de transformer cette “bonne nouvelle” statistique en améliorations concrètes dans les logements, et pas seulement sur le papier.