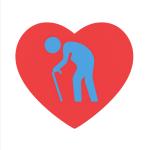Afficher les titres Masquer les titres
Alors que la France s’apprête à rouvrir le débat sur sa réforme des retraites, un autre pays attire tous les regards. Les Pays-Bas viennent d’être désignés comme le pays offrant le système de retraite le plus solide et le plus sûr selon le cabinet Mercer, qui compare chaque année 52 régimes dans le monde. La combinaison d’une pension publique stable, d’une épargne collective performante et d’une capitalisation individuelle bien encadrée fait des Néerlandais des champions de la retraite. Zoom sur ce modèle qui fascine et qui questionne.
Une architecture en trois piliers
Le système néerlandais repose sur trois niveaux complémentaires, garantissant à la fois sécurité et diversité dans la couverture :
- Pension publique de base : appelée AOW, elle est versée à partir de 67 ans et concerne toute personne ayant résidé et cotisé aux Pays-Bas. Son montant avoisine 1 350 euros par mois pour une personne seule, assurant un minimum de confort
- Retraite professionnelle : véritable moteur du système, elle est financée à parts égales par les employeurs et les salariés. Les fonds de pension investissent ces cotisations sur les marchés financiers et disposent aujourd’hui de réserves colossales, près de 1 500 milliards d’euros en 2023, soit environ deux fois le PIB national
- Épargne individuelle : laissée à l’initiative des citoyens les plus prévoyants, elle permet de compléter la pension officielle et de personnaliser sa retraite
Cette combinaison hybride allie solidarité nationale et capitalisation prudente, offrant à chacun un filet de sécurité tout en permettant de profiter de ses économies.
Les différences majeures avec la France
En France, le système est presque exclusivement basé sur la répartition. Les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Mais le déséquilibre démographique rend cette mécanique fragile, obligeant le gouvernement à ajuster fréquemment l’âge légal et la durée de cotisation.
Aux Pays-Bas, la logique est différente. Solidarité publique et capitalisation collective coexistent harmonieusement. Les fonds sont gérés par des professionnels sous contrôle des partenaires sociaux et de l’État, avec une transparence totale. Les Néerlandais acceptent que les pensions puissent évoluer selon les performances financières, ce qui rend le système plus flexible et plus résilient.
Le taux de remplacement moyen illustre cette différence : 93,2 % aux Pays-Bas contre 70,1 % en France. Concrètement, une personne seule en retraite perçoit près de 1 350 euros par mois avec la pension de base néerlandaise, alors qu’en France, un salarié avec un salaire moyen obtient environ 1 800 euros, moins que le niveau garanti aux Pays-Bas.
Pourquoi ce système inspire-t-il la France ?
Importer un tel modèle impliquerait une véritable révolution culturelle. En France, la capitalisation est souvent perçue comme risquée, synonyme de spéculation ou d’inégalités. Aux Pays-Bas, elle est associée à stabilité et confiance grâce à une gouvernance stricte et partagée.
Ce système démontre qu’il est possible d’assurer un haut niveau de pension tout en préservant l’équilibre financier. La clé réside dans :
- Une gestion transparente et professionnelle des fonds
- Une répartition équilibrée entre public et privé
- Une confiance durable des citoyens dans la mécanique financière
Pour la France, qui opte actuellement pour des ajustements progressifs plutôt qu’une refonte totale, l’exemple batave représente une source d’inspiration. Il montre que pensions confortables et soutenabilité budgétaire peuvent coexister, mais qu’il faut accepter une évolution des mentalités et un partage clair des responsabilités entre l’État, les entreprises et les citoyens.
Le rôle de la confiance et de la flexibilité
La réussite néerlandaise repose aussi sur la flexibilité. Les citoyens comprennent que le système doit s’adapter aux performances économiques et aux marchés financiers, et non garantir un droit figé. Cette souplesse permet de maintenir l’équilibre même en période de turbulences économiques et de renforcer l’adhésion sociale au dispositif.
En France, l’opinion publique est souvent attachée à un système fixe, ce qui complique les réformes structurelles. Le modèle néerlandais rappelle que l’adaptabilité et la transparence peuvent renforcer la confiance et la pérennité.
Un modèle qui fascine et qui questionne
Alors que Paris se prépare à rouvrir le débat sur les retraites, le système néerlandais est un exemple frappant : haut niveau de prestations, capitalisation encadrée et gouvernance transparente. Il montre que l’on peut combiner sécurité sociale et rendement financier, avec des réserves impressionnantes, près de deux fois le PIB national.
Cette expérience inspire le débat français, même si sa transposition nécessiterait un changement culturel profond et un partage clair des responsabilités entre l’État, les employeurs et les citoyens. Elle prouve surtout qu’il est possible de concilier confort des retraités et soutenabilité financière sur le long terme.
En regardant vers Amsterdam, la France peut imaginer des pistes pour renforcer son système, tout en garantissant une retraite digne pour tous.