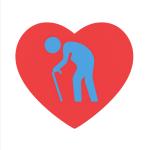Afficher les titres Masquer les titres
Les fins de contrat se multiplient et les profils des demandeurs d’emploi évoluent. Selon une étude récente de l’Unédic, de plus en plus de Français rejoignent France Travail après des contrats précaires ou des ruptures conventionnelles. Ces chiffres offrent un éclairage sur les mécanismes qui conduisent aujourd’hui à l’inscription au chômage et sur les coûts pour le système.
Un profil dominé par les contrats précaires
L’étude, publiée le 6 novembre 2025, porte sur les 3,8 millions d’inscrits à France Travail (anciennement Pôle emploi). Tous ne perçoivent pas d’allocation, mais 2,7 millions ont été indemnisés en 2024. Parmi eux, près de la moitié sont arrivés après un contrat précaire : CDD, contrat saisonnier, alternance ou mission d’intérim.
L’autre moitié est issue d’une rupture de contrat, souvent un CDI. Seuls 5 % des inscrits viennent d’un licenciement économique, principalement des salariés plus âgés dont l’entreprise était en difficulté. La même proportion concerne les licenciements pour inaptitude, affectant surtout des seniors. Enfin, environ 10 % rejoignent France Travail après un licenciement pour faute, un profil majoritairement masculin et âgé de moins de 40 ans.
Les ruptures conventionnelles en hausse
La majorité des fins de contrat se font désormais via une rupture conventionnelle, c’est-à-dire une séparation à l’amiable entre employeur et salarié. Ces ruptures représentent 20 % des inscriptions à France Travail. L’IPP (Institut des politiques publiques) souligne que ces ruptures ont remplacé une partie des démissions, car elles permettent de bénéficier des allocations chômage, contrairement aux démissions classiques. Dans les faits, elles fonctionnent comme des « démissions déguisées ».
Le gouvernement s’inquiète de cette tendance. Ces ruptures concernent principalement des salariés âgés de 30 à 40 ans, qualifiés et employables, et freinent parfois la reprise d’emploi. Leur coût est élevé : 10 milliards d’euros en 2024 sur les 37 milliards d’euros versés par France Travail.
Des situations particulières coûteuses
L’étude de l’Unédic met également en lumière les travailleurs frontaliers, notamment ceux travaillant en Suisse. Bien qu’ils ne représentent que 50 000 personnes inscrites, leur indemnisation a coûté 800 millions d’euros à la France en 2024. Ces dispositifs spécifiques pourraient être revus pour limiter la dépense.
Une analyse qui interpelle
Ces données révèlent plusieurs tendances :
- la moitié des inscrits arrivent après un contrat précaire ;
- les ruptures conventionnelles remplacent de plus en plus les démissions ;
- les licenciements économiques et pour inaptitude touchent surtout les seniors ;
- les travailleurs frontaliers représentent un coût disproportionné par rapport à leur nombre.
En résumé, France Travail accueille un public varié, mais avec une concentration notable sur les contrats précaires et les ruptures conventionnelles. Le système doit s’adapter à ces évolutions pour rester efficace et maîtriser les dépenses publiques.
Pour les demandeurs d’emploi, cela signifie que les profils d’arrivée sont de plus en plus diversifiés et que la préparation administrative, la connaissance des droits et des dispositifs disponibles sont essentielles pour tirer le meilleur parti des aides et allocations.
Cette étude montre que le chômage n’est plus seulement lié aux licenciements économiques : les fins de contrats choisies à l’amiable ou les situations précaires occupent une place centrale dans le paysage de l’emploi. Comprendre ces mécanismes est crucial pour les candidats à l’emploi comme pour les décideurs.