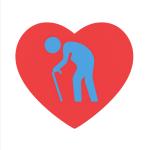Afficher les titres Masquer les titres
Depuis son lancement en 2021, le télescope spatial James Webb n’a cessé de surprendre les astronomes. Chronologie des galaxies, formation des trous noirs ou composition chimique de l’Univers primordial : ses observations bousculent les certitudes. Mais la découverte la plus étonnante concerne un trou noir gigantesque qui, selon nos modèles actuels, ne devrait même pas exister.
Un monstre cosmique dans l’Univers jeune
Le 17 septembre 2025, une équipe d’astronomes a publié dans Nature Astronomy l’observation d’un point rouge à peine perceptible dans le cosmos : J1007_AGN. Ce trou noir supermassif a été identifié alors que l’Univers n’avait que 700 millions d’années, soit un bébé à l’échelle cosmique. Or, selon la physique moderne, un trou noir de cette taille n’aurait pas eu le temps de se former si rapidement.
Avec une masse estimée à 500 millions de soleils, J1007_AGN engloutit tout ce qui passe à sa portée : gaz, poussières, étoiles entières. Mais normalement, la limite d’Eddington fixe une vitesse maximale d’accrétion : au-delà, la lumière émise par le trou noir repousse la matière entrante. Pour atteindre cette masse, il aurait fallu plusieurs milliards d’années, et non 700 millions.
Une croissance inexplicable
Les astronomes envisagent deux scénarios pour expliquer l’existence de ce colosse :
- J1007_AGN serait né d’un nuage de gaz primordial, qui se serait effondré rapidement sous sa propre gravité ;
- Il aurait traversé une phase d’accrétion continue, absorbant de la matière sans interruption, dépassant même la limite d’Eddington.
Quelle que soit l’explication, ce trou noir oblige les scientifiques à repenser la chronologie des premières structures formées après le Big Bang. L’Univers primordial n’était peut-être pas un simple brouillard lentement structuré par la gravité, mais un système beaucoup plus efficace dans la conversion de matière en énergie.
Des galaxies à l’envers ?
Autour de J1007_AGN, huit galaxies ont été repérées à des distances similaires, formant une surdensité environ trente fois supérieure à la moyenne. Ce regroupement suggère qu’elles font partie d’un même halo de matière noire équivalant à 10¹² masses solaires, typique des environnements de quasars.
Le paradoxe est frappant : selon le modèle cosmologique standard, les galaxies apparaissent d’abord, puis les trous noirs supermassifs se forment au centre. Ici, c’est exactement l’inverse : le trou noir est central et les galaxies l’entourent. « Cela pourrait signifier que les trous noirs ont précédé la formation des grandes structures galactiques », avancent les chercheurs.
Des quasars cachés
Une hypothèse pour expliquer ces observations est que ces little red dots représentent une phase précoce des quasars. Ces trous noirs supermassifs seraient en pleine croissance, mais encore enfouis dans un cocon de gaz et de poussière qui masque leur lumière. Durant cette période, ils seraient actifs presque en permanence, absorbant la matière presque 100 % du temps, contre seulement 1 % pour les quasars visibles en ultraviolet.
Si c’est exact, les quasars que nous observons aujourd’hui ne sont que la phase finale et visible d’une croissance beaucoup plus longue. Auparavant, les trous noirs auraient grandi dans l’ombre, entourés de poussière, avant que leur rayonnement ne devienne perceptible.
Une révision nécessaire des modèles
Les scientifiques restent prudents : un seul objet comme J1007_AGN ne suffit pas pour bouleverser complètement les théories cosmologiques. Mais cette observation montre que les modèles actuels sont incomplets. Une période intermédiaire aurait pu exister entre la naissance du cosmos et celle des premières galaxies, durant laquelle ces trous noirs embryonnaires auraient structuré la matière autour d’eux.
Si cette hypothèse se confirme, il faudra inverser la hiérarchie cosmique : les galaxies n’auraient pas nourri les trous noirs, ce seraient ces derniers qui auraient façonné la naissance des galaxies.
Avec J1007_AGN, le télescope James Webb ouvre une fenêtre sur un Univers beaucoup plus dynamique que prévu. Cette découverte nous rappelle que l’Univers recèle encore des mystères et que notre histoire du Big Bang est loin d’être définitivement écrite.