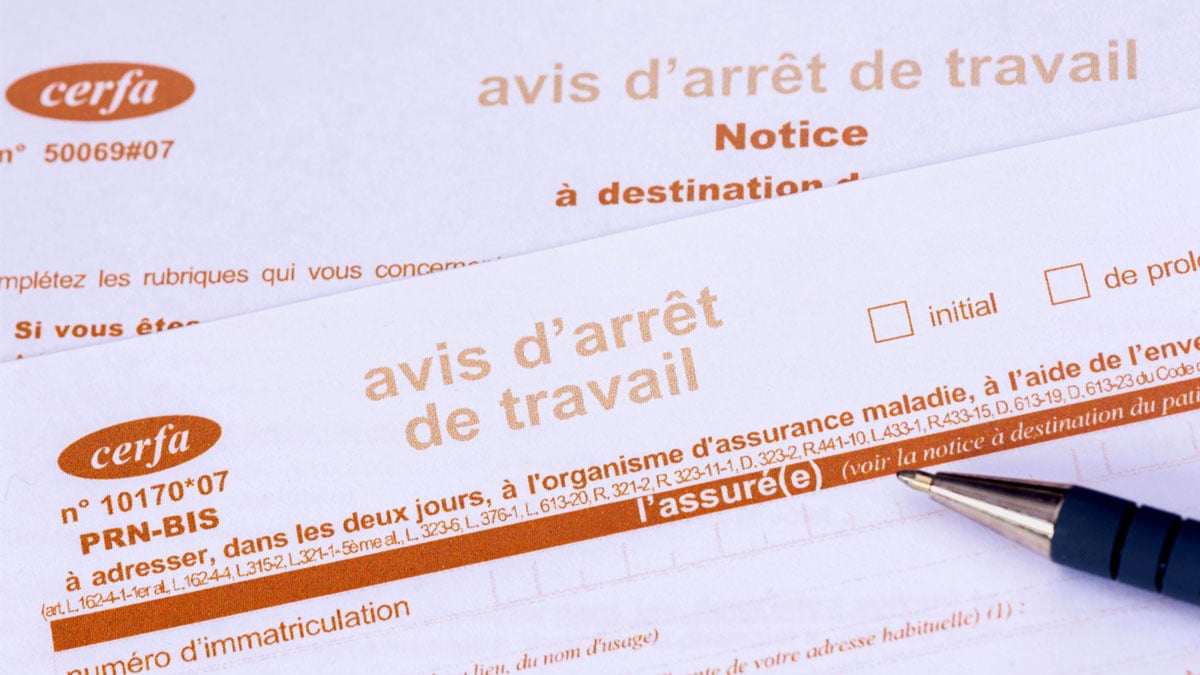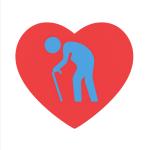Afficher les titres Masquer les titres
- Un projet qui fait débat
- Quand la grippe ne rime plus avec arrêt
- Deux mois de télétravail à la place d’un arrêt complet
- Des employeurs déjà adeptes de la méthode
- Un dispositif qui ne concernera pas tout le monde
- Les avantages et les limites d’une telle mesure
- Une idée qui interroge sur le rapport au travail
Et si, au lieu de rester cloué au lit avec un arrêt-maladie, vous pouviez continuer à travailler depuis chez vous ? C’est l’idée, pour le moins audacieuse, que propose Stéphane Viry, député des Vosges. Selon lui, autoriser les médecins à prescrire du télétravail plutôt qu’un arrêt-maladie permettrait de réduire les absences, de maintenir l’activité des entreprises et d’éviter certains abus. Un projet qui ne laisse personne indifférent et qui divise déjà salariés et employeurs.
Un projet qui fait débat
La proposition de Stéphane Viry a été discutée lors de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Deux amendements identiques ont été adoptés en commission des Affaires sociales, ouvrant la voie à cette idée surprenante. Concrètement, le médecin pourrait, en accord avec l’employeur et le salarié, décider d’un télétravail temporaire à la place d’un arrêt-maladie classique.
Pour le député, il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité : « Ce serait au libre choix du salarié d’accepter ou non la prescription du médecin », a-t-il précisé sur RMC. Il y voit une mesure « gagnant-gagnant » : l’entreprise évite les absences prolongées, tandis que le salarié garde une partie de son salaire et évite les jours de carence.
Quand la grippe ne rime plus avec arrêt
Certains salariés estiment qu’il est tout à fait possible de travailler malgré une petite maladie. Jonathan, prestataire indépendant, y voit un moyen d’éviter les excès : « Cela permettrait d’éviter les abus et les arrêts de complaisance. Le médecin pourrait dire : je mets un arrêt, mais ce sera du télétravail. Vous n’allez pas me dire que quand vous avez une grippe, vous ne pouvez pas télétravailler ! »
Selon lui, le télétravail ne doit pas être vu comme une sanction, mais comme une alternative souple et adaptée. Il permettrait aux personnes légèrement malades de continuer leur activité sans risquer de contaminer leurs collègues. Le mot-clé ici : responsabilité.
Deux mois de télétravail à la place d’un arrêt complet
Certains ont déjà expérimenté une version de cette idée. Julien, employé territorial en Gironde, raconte son cas : « Je me suis fait mal au genou, j’avais une nécrose. Ma médecin m’a interdit de poser le pied par terre pendant deux mois. J’ai donc demandé à passer à 100 % en télétravail. Mon employeur a accepté, et j’ai pu continuer à travailler sans m’arrêter. »
Grâce à son matériel informatique et à de nombreuses visioconférences avec ses collègues, Julien a pu rester pleinement intégré à son équipe. Une situation qui montre que, pour certains métiers, le télétravail peut être un vrai levier d’adaptation, surtout quand le salarié reste apte à travailler intellectuellement.
Des employeurs déjà adeptes de la méthode
Dans certaines petites entreprises, cette pratique existe déjà de manière informelle. Anthony, patron d’une TPE en Corse, a mis en place un système simple et humain : « Quand un salarié n’est pas en capacité de venir travailler mais qu’il peut le faire depuis chez lui, on se met d’accord. Plutôt qu’un arrêt, on active le télétravail automatiquement. Cela évite les trois jours de carence et une visite inutile chez le médecin. »
Pour lui, pas besoin de nouvelle loi : le bon sens suffit. Il estime qu’il ne faut pas « ajouter des normes là où il faudrait en supprimer ». Cette flexibilité, selon lui, permet d’entretenir une relation de confiance entre employeur et salarié, tout en maintenant la productivité.
Un dispositif qui ne concernera pas tout le monde
Malgré l’enthousiasme de certains, cette proposition reste limitée. En France, seuls environ 30 % des salariés exercent un métier compatible avec le télétravail. Les autres, notamment dans les secteurs manuels ou de terrain, ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif.
Le député Stéphane Viry insiste sur ce point : « Je n’impose rien. Ce n’est pas une norme supplémentaire, juste une faculté que le droit du travail pourrait reconnaître. » Pour lui, le but n’est pas de remplacer totalement les arrêts maladie, mais d’offrir une alternative pour les situations où le travail à distance reste possible.
Les avantages et les limites d’une telle mesure
Les défenseurs du projet mettent en avant plusieurs points positifs :
- limiter les absences longues pour les entreprises ;
- réduire les coûts liés aux jours de carence pour les salariés ;
- éviter certains abus liés aux arrêts de complaisance ;
- maintenir un lien social et professionnel malgré la maladie.
Mais d’autres y voient des dérives possibles. Certains syndicats redoutent une pression implicite sur les salariés, les poussant à travailler même lorsqu’ils ne sont pas en état. Le risque serait d’effacer la frontière entre repos médical et obligation de performance. D’autres craignent aussi que cela crée une inégalité entre les métiers « télétravaillables » et ceux qui ne le sont pas.
Une idée qui interroge sur le rapport au travail
Cette proposition soulève une question de fond : notre rapport à la maladie et au travail. Peut-on vraiment être efficace lorsqu’on n’est pas en pleine forme ? Faut-il à tout prix rester productif, même souffrant ?
Pour certains, cette évolution illustre la transformation du monde du travail, où la flexibilité prime sur le repos. Pour d’autres, elle ouvre la voie à un équilibre plus intelligent entre activité et santé. Une chose est sûre : le télétravail continue de s’imposer comme une solution clé des années à venir, mais il reste à encadrer pour éviter les dérives.
Le débat ne fait que commencer. Si l’amendement venait à être adopté, il pourrait changer durablement la façon dont les Français vivent la maladie… et leur travail.