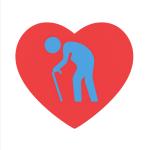Afficher les titres Masquer les titres
- Un nouveau gouvernement face à un mur énergétique
- EDF revoit ses ambitions à la baisse
- Instabilité politique et émissions en hausse
- Le biométhane, un rêve trop coûteux ?
- Déchets nucléaires : un débat public explosif
- Des réformes à venir sur les prix de l’électricité
- L’Europe et le monde sous tension
Un nouveau gouvernement face à un mur énergétique
Le 13 octobre 2025 marque l’entrée en fonction d’une nouvelle équipe gouvernementale chargée de redresser une situation énergétique tendue. Monique Barbut prend les rênes de la Transition écologique, épaulée par Roland Lescure à l’Économie et à l’Énergie, et Vincent Jeanbrun au Logement, un portefeuille stratégique pour la rénovation thermique. Cette équipe devra piloter la transition tout en préservant le pouvoir d’achat des ménages déjà mis à rude épreuve.
EDF revoit ses ambitions à la baisse
Le choc est venu d’EDF. L’énergéticien a transmis à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) des prévisions de production nucléaire stables, autour de 360 TWh, bien loin de l’objectif de 400 TWh annoncé pour 2030. Autrement dit, l’entreprise renonce à augmenter la puissance de son parc existant. Une décision perçue comme une « douche froide » par le gouvernement, qui comptait sur une production accrue pour garantir la souveraineté énergétique et limiter les hausses de tarifs.
Ce recul pose question : comment concilier sobriété, décarbonation et sécurité énergétique sans un parc nucléaire plus performant ? Les syndicats d’EDF, eux, dénoncent un manque de moyens et d’anticipation face à la maintenance et au renouvellement du parc.
Instabilité politique et émissions en hausse
Avant de quitter son poste, Agnès Pannier-Runacher a lancé un avertissement : selon elle, l’instabilité politique freine les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. *Les politiques de « stop-and-go » sur la rénovation thermique et les véhicules électriques nuisent à la cohérence de la transition*, a-t-elle déploré. En clair, les changements de cap successifs auraient ralenti la mise en œuvre de projets structurants et découragé les investisseurs.
Le biométhane, un rêve trop coûteux ?
Autre dossier brûlant : le biométhane. L’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) tire la sonnette d’alarme. Selon lui, la politique actuelle de soutien au biométhane serait intenable financièrement. Les objectifs de production et de coût pèseraient jusqu’à 3 milliards d’euros par an sur les finances publiques. L’institut appelle donc à revoir le cadre d’aide et à mieux cibler les usages prioritaires, notamment dans les transports et les collectivités.
Déchets nucléaires : un débat public explosif
La Commission nationale du débat public (CNDP) vient d’ouvrir les discussions sur la gestion des déchets radioactifs pour la période 2027-2031. Ce débat, qui s’annonce vif, abordera des thèmes sensibles : le financement du stockage, la prolongation des sites existants et surtout le controversé projet Cigéo à Bure. Le sujet promet de raviver les tensions entre partisans du nucléaire et défenseurs de la sortie progressive de l’atome.
Des réformes à venir sur les prix de l’électricité
Dans ce contexte, plusieurs pistes de réforme circulent. Parmi elles, l’idée d’un « acheteur unique » chargé de centraliser l’achat et la revente de toute l’électricité produite en France. Objectif : mieux réguler les prix et les rapprocher des coûts réels de production. Le Sénat, de son côté, souhaite créer une commission indépendante pour fixer les prix de cession des barrages hydroélectriques arrivant à échéance, afin d’éviter toute spéculation.
En parallèle, la CRE vient d’annoncer une baisse de 15 à 16 % des tarifs d’achat pour le solaire industriel, alors que les installations résidentielles restent stables. Une mesure qui pourrait freiner certains projets, mais encourager les particuliers à investir dans l’autoconsommation.
L’Europe et le monde sous tension
Sur le plan international, la situation évolue rapidement. La récente annonce d’un cessez-le-feu à Gaza a entraîné une baisse immédiate du prix du pétrole, désormais fragilisé par la hausse des stocks américains. De son côté, l’Union européenne avance sur une directive sur l’efficacité énergétique imposant aux États membres de réduire de 11,7 % leur consommation d’ici 2030. Le secteur public devra notamment rénover 3 % de ses bâtiments chaque année.
Enfin, un projet de marché du carbone commun entre l’UE et le Royaume-Uni refait surface. L’objectif serait d’éviter les fuites de carbone et de garantir une concurrence équitable. Bruxelles prévoit également la mise en place d’un Fonds social pour le climat de 86 milliards d’euros, destiné à soutenir les ménages modestes et les petites entreprises face au coût de la transition énergétique.
Entre ambitions climatiques et contraintes économiques, la France entre dans une nouvelle ère énergétique. Mais si le gouvernement veut tenir ses promesses, il devra convaincre qu’il peut faire mieux avec moins, tout en regagnant la confiance d’un secteur déjà sous tension.