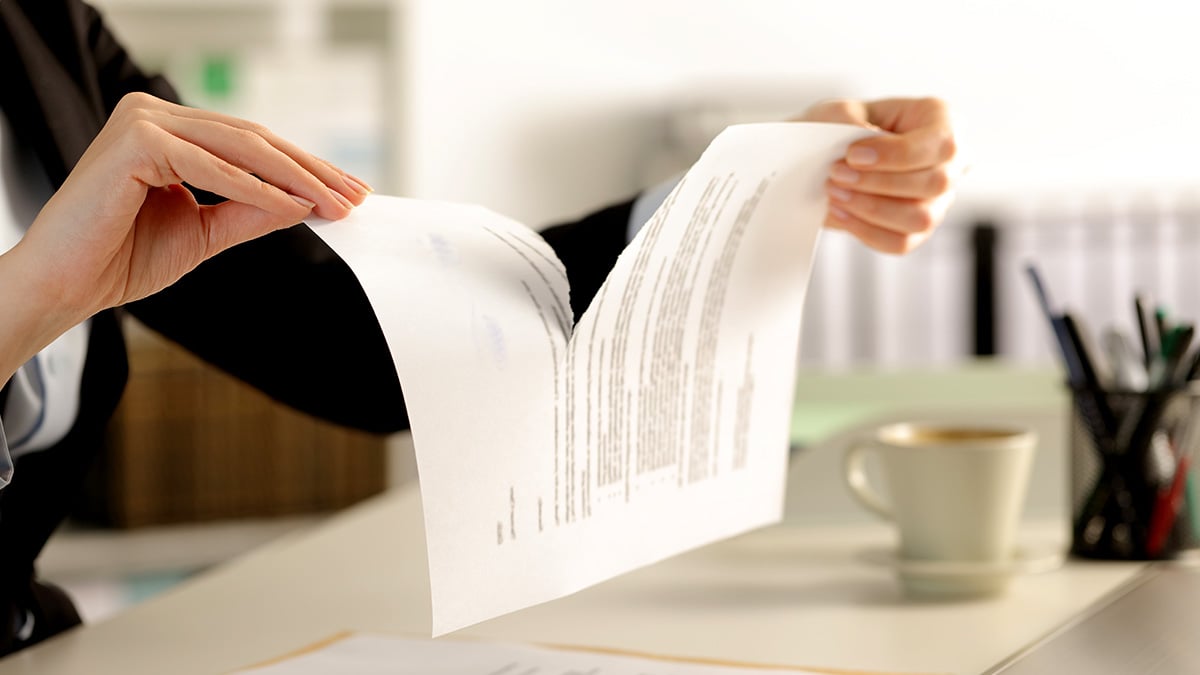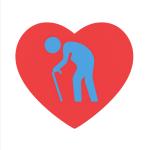Afficher les titres Masquer les titres
Le gouvernement français prépare une réforme qui pourrait changer la donne pour les salariés souhaitant quitter leur emploi via une rupture conventionnelle. L’objectif officiel : réduire le coût pour les finances publiques. Mais cette mesure risque de bouleverser le quotidien de nombreux employeurs et salariés, qui pourraient voir ce dispositif devenir plus complexe et moins attractif.
Ruptures conventionnelles : un mécanisme sous pression
Depuis 2008, la rupture conventionnelle permet aux salariés de mettre fin à leur contrat de travail tout en percevant des allocations chômage. Très pratique pour ceux qui souhaitent changer de carrière ou quitter une entreprise sans conflit, ce dispositif représente aujourd’hui une charge importante pour l’État. En 2024, plus de 514 000 ruptures conventionnelles ont été signées, pour un coût de 9,4 milliards d’euros, soit environ 25 % des dépenses totales d’allocations chômage.
Face à cette situation, le gouvernement envisage un durcissement de l’accès au dispositif. L’idée est de limiter les abus et de mieux encadrer les départs volontaires tout en allégeant la facture publique.
Les mesures envisagées par le gouvernement
Le Premier ministre Sébastien Lecornu propose d’augmenter la contribution patronale que les entreprises versent à l’Urssaf pour chaque rupture conventionnelle de CDI. Actuellement fixée à 30 %, cette taxe pourrait grimper jusqu’à 40 % dès 2026. Le but est double :
- Décourager un recours trop fréquent au dispositif ;
- Augmenter les recettes pour la Sécurité sociale ;
Astrid Panosyan-Bouvet, ancienne ministre du Travail, confirme cette volonté gouvernementale tout en soulignant les abus existants. De son côté, Romain Thiesset, avocat associé chez Capstan Avocats, note : « Cette hausse réduira probablement le nombre de ruptures conventionnelles, mais elle pourrait rapporter moins que prévu. »
Conséquences possibles et débats
Les spécialistes anticipent plusieurs effets secondaires. Certains employeurs pourraient se tourner vers des solutions détournées, comme des licenciements accompagnés d’accords transactionnels, pour éviter le surcoût. Romain Thiesset explique : « S’il existe une volonté commune entre l’employeur et le salarié de mettre fin au contrat de travail, il y a un risque important qu’ils contournent le dispositif. »
Bertrand Martinot rappelle que beaucoup de ruptures auraient eu lieu même sans ce mécanisme. Patrick Martin, lui, insiste sur la nécessité d’améliorer le système sans le supprimer. Ces discussions impliquent syndicats, patronat et représentants sociaux, tous à la recherche d’un équilibre pour réformer le dispositif.
Démarches pour encadrer les ruptures
Pour éviter les abus, plusieurs pistes sont à l’étude :
- Allonger le délai de carence avant de toucher les allocations chômage ;
- Réduire ou supprimer les indemnités pour certains types de ruptures ;
- Renforcer le contrôle des démarches pour vérifier que la recherche d’emploi est réelle après la rupture ;
Jean Tirole, expert économique, insiste sur l’importance de favoriser une recherche active d’emploi, afin que les ruptures conventionnelles restent un outil de transition et non une solution pour contourner les règles.
Un dispositif sous surveillance
En résumé, la réforme prévue pour 2026 pourrait rendre les ruptures conventionnelles plus coûteuses et complexes. Les salariés devront mieux anticiper leurs démarches, et les entreprises réfléchiront davantage avant de recourir à ce mécanisme. Le débat reste ouvert entre protection des finances publiques et maintien d’un outil pratique pour les transitions professionnelles. Quel que soit l’angle, l’important reste de trouver un équilibre qui préserve les droits des salariés tout en limitant les excès.